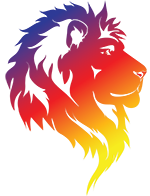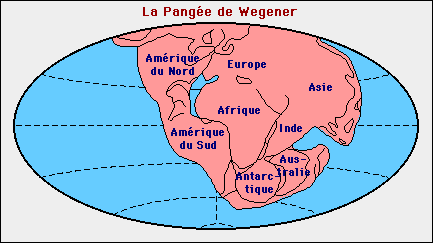Le peuple mormon est le nom donné aux membres de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, une religion fondée au XIXe siècle par Joseph Smith aux États-Unis. Les mormons se basent sur la Bible, mais aussi sur le Livre de Mormon, qu’ils considèrent comme une autre révélation de Dieu. Ils croient que le Christ reviendra sur terre pour établir son royaume, et que les hommes peuvent devenir comme Dieu s’ils suivent ses commandements.
L’histoire du mormonisme commence avec la vision de Joseph Smith, qui affirme avoir été visité par Dieu et par un ange nommé Moroni, qui lui révèle l’existence de tablettes d’or contenant l’histoire d’un ancien peuple d’Amérique, les Néphites, qui auraient reçu la visite du Christ après sa résurrection. Smith traduit ces tablettes en anglais et publie le Livre de Mormon en 1830, année où il fonde l’Église de Jésus-Christ. Il prétend également recevoir d’autres révélations, notamment sur la pratique de la polygamie, qu’il instaure parmi ses fidèles.
Le mouvement mormon suscite la méfiance et l’hostilité des autres chrétiens, qui le considèrent comme une secte hérétique. Smith et ses adeptes sont persécutés et chassés de plusieurs États, jusqu’à ce qu’ils trouvent refuge dans l’Utah, où ils fondent la ville de Salt Lake City en 1847. Smith est assassiné en 1844 par une foule en colère, et son successeur, Brigham Young, devient le leader des mormons. Sous son autorité, l’Église se développe et s’organise, en envoyant des missionnaires dans le monde entier et en construisant des temples sacrés.
Aujourd’hui, les mormons comptent plus de 15 millions de membres, dont la majorité vit aux États-Unis. Ils sont connus pour leur mode de vie conservateur, leur engagement social et leur prosélytisme. Ils respectent des règles strictes de moralité, comme l’abstinence de tabac, d’alcool, de café et de thé, le port de vêtements modestes, le paiement de la dîme et le service dans l’Église. Ils pratiquent également le baptême pour les morts, qui consiste à baptiser par procuration les ancêtres décédés qui n’ont pas eu l’occasion de connaître l’Évangile. Ils croient que la famille est éternelle, et qu’ils peuvent être scellés à leurs conjoints et à leurs enfants dans les temples.
Le mormonisme est une religion diverse, qui comprend plusieurs branches et courants. L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, basée à Salt Lake City, est la plus grande et la plus influente, mais il existe aussi d’autres Églises qui se réclament de l’héritage de Joseph Smith, comme la Communauté du Christ, qui rejette la polygamie et affirme le trinitarisme. Il y a aussi des groupes dissidents, appelés fondamentalistes mormons, qui continuent à pratiquer la polygamie et qui vivent en marge de la société.
Le mormonisme est une religion qui fascine et qui interroge, par son histoire, sa doctrine et sa culture. Il est à la fois proche et différent du christianisme, et il cherche à se faire reconnaître comme une foi authentique et respectable
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »1_5,1_5,1_5,1_5,1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » global_module= »3614″ theme_builder_area= »post_content »][et_pb_column type= »1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_button button_url= »https://tomystere.com/category/geographie/ » button_text= »GEOGRAPHIE » button_alignment= »center » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_button][et_pb_blog posts_number= »2″ include_categories= »319″ use_manual_excerpt= »off » show_author= »off » show_date= »off » show_categories= »off » show_excerpt= »off » show_pagination= »off » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » header_level= »h3″ header_font= »|||||||| » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_blog][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_button button_url= »https://tomystere.com/category/histoire-en-resume/ » button_text= »HISTOIRE » button_alignment= »center » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_button][et_pb_blog posts_number= »2″ include_categories= »329″ use_manual_excerpt= »off » show_author= »off » show_date= »off » show_categories= »off » show_excerpt= »off » show_pagination= »off » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » header_level= »h3″ header_font= »|||||||| » text_orientation= »center » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_blog][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_button button_url= »https://tomystere.com/category/tsc-voyages/ » button_text= »VOYAGES » button_alignment= »center » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_button][et_pb_blog posts_number= »2″ include_categories= »92″ use_manual_excerpt= »off » show_author= »off » show_date= »off » show_categories= »off » show_excerpt= »off » show_pagination= »off » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » header_level= »h3″ header_font= »|||||||| » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_blog][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_button button_url= »https://tomystere.com/category/wildlife-vie-sauvage-fauna-selvaggia/ » button_text= »VIE SAUVAGE » button_alignment= »center » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_button][et_pb_blog posts_number= »2″ include_categories= »81″ use_manual_excerpt= »off » show_author= »off » show_date= »off » show_categories= »off » show_excerpt= »off » show_pagination= »off » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » header_level= »h3″ header_font= »|||||||| » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_blog][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_5″ _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][et_pb_button button_url= »https://tomystere.com/category/photography/ » button_text= »PHOTOGRAPHIE » button_alignment= »center » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_button][et_pb_blog posts_number= »2″ include_categories= »85″ use_manual_excerpt= »off » show_author= »off » show_date= »off » show_categories= »off » show_excerpt= »off » show_pagination= »off » _builder_version= »4.24.0″ _module_preset= »default » header_level= »h3″ header_font= »|||||||| » global_colors_info= »{} » theme_builder_area= »post_content »][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]